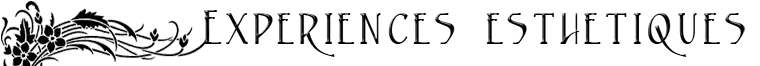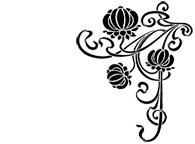

Musique du
Temps Présent
LIENS RELATIFS
Mediamus : Cherchez la vidéo sur Ligeti, il s'agit d'une tentative d'animation graphique de l'une de ses partitions.
AUTEUR

GYÖRGY LIGETI (1923-2006)
« Je suis né en Transylvanie et suis ressortissant roumain. Cependant, je ne parlais pas roumain dans mon enfance et mes parents n'étaient pas transylvaniens. [...] Ma langue maternelle est le hongrois, mais je ne suis pas un véritable Hongrois, car je suis juif. Mais, n'étant pas membre d'une communauté juive, je suis un juif assimilé. Je ne suis cependant pas tout à fait assimilé non plus, car je ne suis pas baptisé. » Voilà comment aimait se présenter Ligeti, juif à l’étoile jaune, écarté de l’Université dans les années 40. Néanmoins, il rentre au conservatoire de Cluj, mais il est incorporé en 44 dans les compagnies de travail obligatoire de l'armée hongroise où il effectue des travaux forcés à Szeged puis à la forteresse de Nagyvárad (Oradea, en Roumanie). Il s'enfuit de là pour échapper à la déportation et part au conservatoire de Budapest avant d’entamer un périple à travers à Roumanie mettant ses pas dans ceux de Bartók à la recherches de rythmes et de mélodies folkloriques. Professeur à Budapest, il profitera des émeutes de 56 pour quitter l’Est en direction de l’Allemagne où il découvre enfin la musique contemporaine auprès de Karlheinz Stockhausen.
Le parcourt de Ligeti explique pour beaucoup sa musique et ses émigrations successives font de lui un musicien sans maître, ni écoles, un inclassable assoiffé d’expression et de liberté. Il commence jeune avec des thèmes burlesques ou néo-classiques : des compositions autorisées par les régimes socialistes de l’époque et réglementées par une esthétique stricte. La musica Ricercata composée dans ces années-là ne sera pas jouée en public. Tragique, son numéro 3 résonne « comme un coup de couteau dans le dos de Staline », comme une musique de résistance. Ligeti n’ayant pas accès aux maîtres de l’école de Vienne, devra réinventer de façon solitaire et laborieuse un chemin personnel vers la modernité sans autres repères que Bartók et quelques compositions de Berg. Ainsi même après la découverte des nouveaux compositeurs lors de son arrivée en Allemagne, il ne se bornera pas à des compositions sérielles de type « école de Darmstadt » mais continuera dans une voie propre. Cette voie sera celle qui fera son succès, celle des micro-polyphonies au tissu très serré, truffées de « clusters » (groupes de notes) faisant jouer des micro-intervalles, des timbres superposés, des décalages minuscules par une composition contrapunctique microscopique anéantissant certaines fois mélodies et rythmes. Musique anti-intellectuelle, d’expérience autant qu’expérimentale, canevas affolants, cette musique est une matière que le compositeur sculpte et module. Il trouvera moins d’imitateurs que d’admirateurs dans ces grandes compositions des années 70 que Kubrick reprendra pour illustrer ses films (2001, Shining). Dans le concerto pour 13 instruments, les 13 instruments sont solistes et se partagent la prééminence de l’ensemble créant un univers étrange et redondant où chaque timbre sort tour à tour pour redisparaître avec violence et de façon hypnotique. Vers ses dernières années, il reviendra vers des formes plus simples avec le concerto pour piano occasion pour l’auteur de rajeunir avant de s’endormir.
Œuvres :
-
Concerto pour 13 instrumentistes
-
Le grand macabre (Opéra)
-
Quartet 1 et 2
-
Volumina pour orgue
-
Lontano pour orchestre
-
Musica ricercata pour piano
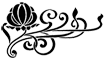 ©EX-ES 2007 ©EX-ES 2007 |
 |
|---|